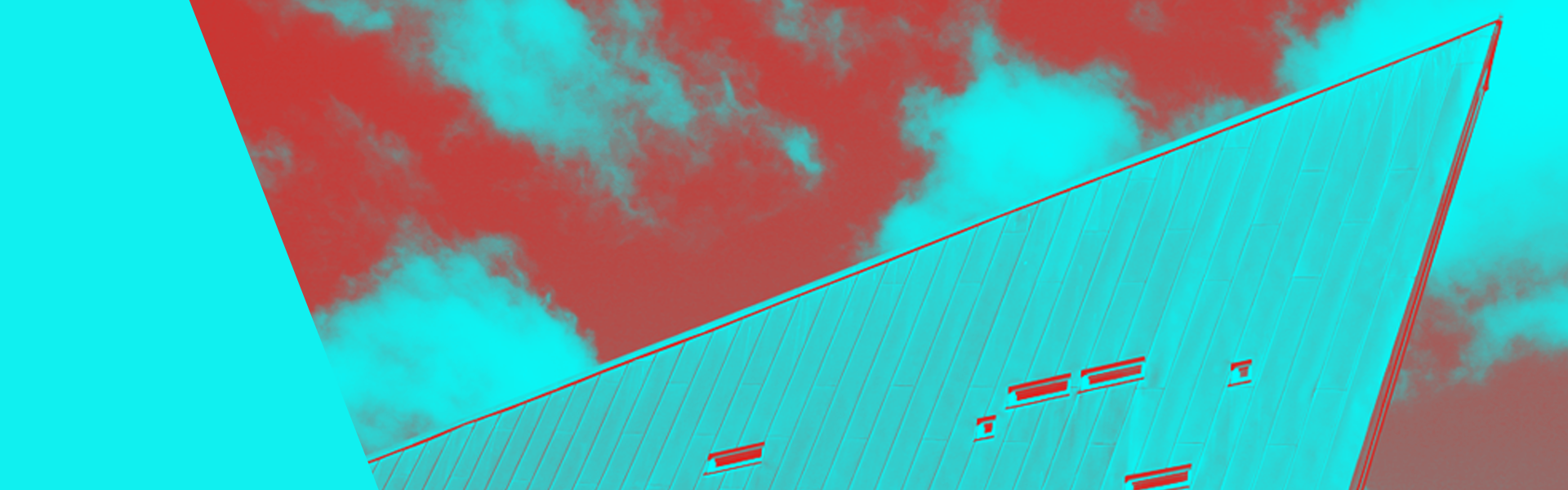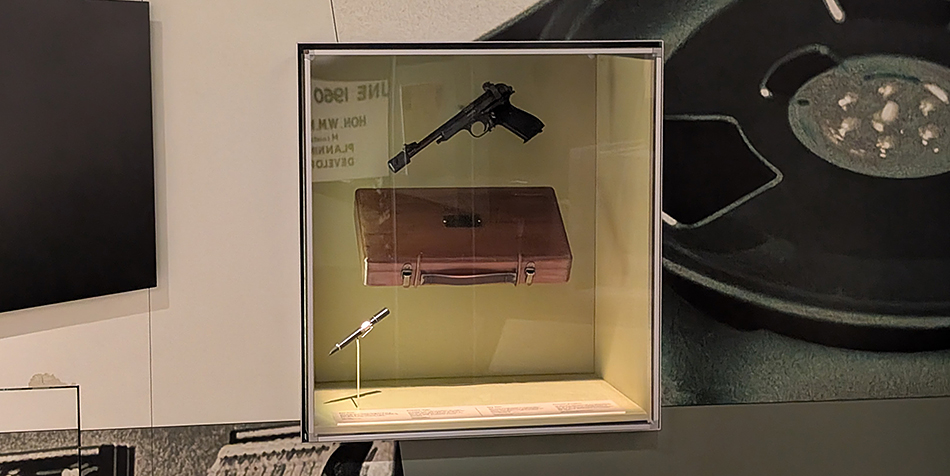Des centaines de milliers de personnes visitent le Musée canadien de la guerre chaque année. Leur expérience débute avant même qu’elles n’ouvrent les portes d’entrée grâce à l’architecture distinctive du bâtiment.
Commémorer et interpréter l’histoire de la guerre est une mission difficile et importante. Les conflits armés touchent à l’ensemble de l’expérience humaine, depuis la violence et la cruauté jusqu’à l’héroïsme et l’espoir.
L’épisode de balado « Béton et lumière » offre un regard intime sur le Musée canadien de la guerre. On y explique comment le bâtiment a été conçu pour interpeler la conscience et servir de source de guérison et de régénération. Dans cet épisode, on écoute les concepteurs et conceptrices du bâtiment, les conservateurs et conservatrices qui y développent des expositions et le personnel qui y travaille tous les jours avec le public.
Vous trouverez ci-dessous certains de leurs commentaires. Écoutez l’épisode complet pour en savoir plus.
Architecture, histoire et espoir
Emmanuelle van Rutten était architecte auxiliaire au sein de l’équipe qui a conçu le bâtiment, sous la direction du regretté Raymond Moriyama. En réfléchissant à ce qu’on ressent en entrant dans le Musée, elle déclare : « Je trouve ça très calme quand on entre dans le foyer. Il y a un moment de sérénité, mais aussi une sorte d’inconfort. »
Cette tension s’applique également à la façade extérieure. Le Musée a été le premier bâtiment construit sur un terrain industriel, gazonné et abandonné depuis longtemps. L’idée que la croissance et le renouveau demeurent possibles après la destruction et la perte a joué un rôle important dans la conception du bâtiment.

Vue aérienne de l’emplacement du Musée canadien de la guerre sur les plaines Lebreton à Ottawa.
Corporation/PCL Constructors
Mme van Rutten explique : « L’une des choses qui nous ont inspirés, c’est l’herbe qui poussait sur le terrain. Elle répondait à beaucoup des concepts que nous explorions sur la nature, la régénération. » Ainsi, à l’ouest et au nord, le bâtiment s’élève organiquement à partir du sol. Son toit vivant en pente donne un sentiment de continuité et de connexion. Mais à l’est, de grandes baies vitrées et un aileron en béton et en métal confèrent au Musée une présence spectaculaire vue de la rue.
De nombreux aspects du bâtiment s’inspirent des matériaux et de l’aspect des structures de l’époque de la guerre. « Il y a des rampes qui mènent à l’espace d’exposition et les murs sont inclinés vers vous. Cela permet de donner l’impression des bunkers, et que l’on se trouve dans un bâtiment très utilitaire et très solide, souligne Mme van Rutten. »

Le béton incliné, qui donne l’aspect d’un bunker, définit la promenade des Commissionnaires, qui relie la galerie Lebreton au foyer.
Musée canadien de la guerre
Raconter des histoires significatives
Il s’agit d’un bâtiment complexe, comme les histoires racontées par les expositions qui s’y trouvent. L’expérience de la guerre est profondément humaine, tant par la tragédie que par l’héroïsme qu’elle comporte. « On ne se contente pas de raconter simplement l’histoire, avec le nombre de personnes qui ont participé à cette bataille, explique l’historienne Danielle Teillet. Nous essayons de partager des histoires personnelles et divers éléments auxquels les gens peuvent s’identifier. »
Mme Teillet possède à la fois une expertise professionnelle et un lien personnel avec l’histoire de la guerre. Son grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a découvert des documents sur des aspects de son expérience dont il n’avait jamais parlé.
Elle y réfléchit lorsqu’elle travaille à des expositions. « On veut partager certaines de ces histoires, tout en reconnaissant qu’il s’agit de personnes réelles, dit-elle. Ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas des statistiques. Chaque personne a une famille, une histoire, des amis, des parents et ses propres expériences. »
Rencontres personnelles
Les visiteurs et les visiteuses arrivent dans le bâtiment pour de nombreuses raisons. Les membres du personnel qui travaillent avec le public donnent souvent des indications et répondent aux questions. Ils et elles offrent aussi parfois une oreille attentive aux récits sincères de connexion, de survie ou de perte.
Une Jeep endommagée de la force de maintien de la paix des Nations Unies est exposée dans la galerie « De la Guerre froide à nos jours ». L’interprète de programme Jacques Giasson travaillait à proximité lorsqu’un visiteur lui a demandé de la voir. Clairement, le visiteur avait eu une forte réaction à la vue du véhicule. M. Giasson se souvient : « Je me suis approché de lui. Je lui ai dit : « Monsieur, il est évident que cette Jeep a un grand impact sur vous. » Il m’a répondu que c’était pour une bonne raison. « C’est moi qui conduisais ce véhicule quand il a été attaqué.” »

Les galeries principales contiennent de nombreux objets significatifs, notamment cette Jeep de l’ONU endommagée pendant la guerre de Yougoslavie.
Musée canadien de la guerre
Il réfléchit : « Ça fait partie de ces moments où, parfois, on rencontre des gens qui ont un lien direct avec les artéfacts que nous avons au Musée. »
Un autre interprète de programme, Rob Gauvin, a également eu une rencontre significative avec une visiteuse qui se trouvait au Musée après avoir vécu une perte tragique. Il a rencontré une femme qui se tenait près d’un véhicule utilisé par les troupes canadiennes en Afghanistan. Elle a révélé que son fils avait été tué pendant qu’il servait là-bas. « Je ne pense pas que j’aurais pu dire quoi que ce soit pour la réconforter, se souvient-il. Elle a eu une émotion et il se trouve que j’étais là au même instant, avec elle. C’était un moment extrêmement fort. C’est un moment que je n’ai jamais oublié. »
Compassion et espoir
Les différents espaces du bâtiment permettent d’aborder toute la gamme des expériences et des émotions liées à la guerre. Le public peut y découvrir des récits de violence, mais vivre aussi des moments de réflexion. Selon Camille Brouzes, interprète de programme, « L’un des espaces les plus propices à la sérénité est la salle de la Régénération. C’est un espace magnifique, parce qu’on y entend un léger sifflement… »

La salle de la Régénération Moriyama se caractérise par un plafond très haut et une bande sonore faisant entendre un léger sifflement de vent.
Musée canadien de la guerre
Dans cette grande pièce, on entend un léger sifflement de vent. Ce son, enregistré dans le bâtiment pendant la construction, rappelait à l’architecte, Raymond Moriyama, la cabane de son enfance. C’était un lieu de réconfort et de consolation dans le camp d’internement où il avait été envoyé avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était aussi sa toute première construction.
« J’ai fait des visites guidées avec des militaires, se souvient Mme Brouzes. Ils disent que ce son les apaise, parce qu’il évoque un bruit blanc. » Des espaces comme la salle de la Régénération Moriyama et la salle du Souvenir accueillent les personnes qui cherchent un lieu de commémoration solennelle ou de réflexion tranquille.
M. Gauvin réfléchit au lien humain que supposent le souvenir et la compréhension d’un conflit. Il explique : « Et en tant que personne qui a toujours aimé l’histoire, je sais qu’il y a des tragédies en temps de guerre et qu’une forme de compassion peut en découler. »
« Raymond a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas de glorifier la guerre, précise Mme van Rutten. Et je pense qu’il était clair pour lui qu’ indépendamment de la présentation de la difficulté de la guerre, il y a aussi la question de l’espoir et de la régénération. »
Pour en savoir plus sur toutes ces histoires, écoutez « Béton et lumière : Au cœur du Musée canadien de la guerre » :

Les grandes fenêtres et le grand aileron du Musée sont orientés vers l’est, vers le centre-ville d’Ottawa et le Parlement.
Musée canadien de la guerre

Steve McCullough
Steve McCullough, Ph. D., est le stratège de contenu numérique pour le Musée canadien de l’histoire et le Musée canadien de la guerre. Son travail dans le domaine de la création de récits numériques repose sur la compassion et des actions fondées sur des preuves pour parler de l’histoire, de la notion de sens et de l’identité dans un environnement en ligne fragmenté et polarisé, mais aussi dynamique et étroitement lié.